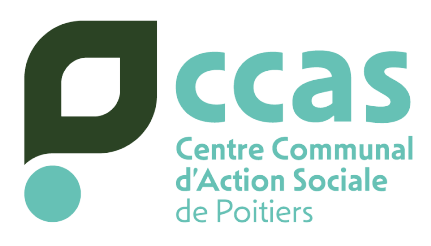Expression politique
Conformément à la loi du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité, reprise notamment à l'article L. 2121-27-1 du CGCT, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux.
Une culture accessible, une ville plus juste
Qu’il s’agisse de théâtre, de musique, de danse, d’arts visuels ou de patrimoine, l’accès à la culture à Poitiers doit être un droit partagé. La culture est l’un de nos vecteurs de cohésion, d’émancipation et d’inclusion. C’est donc de plus de culture dont nous avons besoin. Et cela avec trois exigences : ne pas réduire la politique culturelle de la ville à l’animation de l’espace public, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui à Poitiers ; avoir l’ambition de garantir une offre culturelle exigeante et de proximité ; trouver les leviers pour favoriser l’accès, l’inclusion et la participation de tous les habitants à la vie culturelle. Sur ce dernier point, tant reste à faire et cela implique des choix politiques clairs : tarifs solidaires, gratuités ciblées, soutien aux associations de quartier, multiplication des événements en pied d’immeuble, dans les écoles ou les maisons de retraite. Il faut aller vers les publics éloignés, et non seulement attendre qu’ils franchissent les portes des institutions. Une culture accessible, c’est aussi une culture tissée avec les acteurs : donner la parole, les moyens et l’espace à celles et ceux qui créent localement, et qui innovent. Nous devons avoir l’ambition d’une politique culturelle à la hauteur des enjeux : faire de la culture un levier d’émancipation, un outil de lien social, et une source de fierté partagée. Car une ville qui rend la culture accessible à toutes et tous est une ville plus juste, plus vivante et plus démocratique.
François Blanchard
L’été à Poitiers, une continuité plus qu’une parenthèse
Avec la saison estivale, notre cité poitevine prend un air différent du reste de l’année qui grouille habituellement de sa vie étudiante. Pour autant, Poitiers ne s’endort pas. Elle doit s’organiser pour garantir un même niveau de service aux usagers. C’est une ville qui s’anime pour toutes les générations grâce aux acteurs locaux. C’est une ville pittoresque que l’on aime partager avec les touristes venus la visiter. Poitiers en été, cela doit être une ville plus résiliente dans tous ses quartiers face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. C’est aussi une ville qui doit rester solidaire avec celles et ceux qui n’ont pas la chance de voyager. Pour tout cela, la ville de Poitiers doit investir dans les infrastructures et permettre également aux acteurs sociaux, économiques, sportifs, culturels de s’épanouir pour profiter à l’ensemble de la population et rayonner au-delà d’une seule saison. Poitiers en été doit être le reflet d’un dynamisme qui se construit toute l’année.
Anthony Brottier
L’été : une politique événementielle
L’été doit être synonyme d’une politique culturelle et de loisirs dynamique et diversifiée, visant à animer la ville avec une volonté de démocratisation de la culture et des loisirs. Il est nécessaire de mettre en place une programmation estivale foisonnante, accessible au plus grand nombre, valorisant les espaces publics et le patrimoine exceptionnel de la ville et favorisant le vivre-ensemble. Les événements de l’été doivent refléter une réelle ambition sociale, culturelle et transformer Poitiers en une destination agréable pour passer la période estivale, que l’on soit résident ou visiteur.
Le Groupe
Investir pour l’avenir, défendre nos territoires
Transition écologique, justice sociale, solidarité de proximité : les collectivités locales sont en première ligne pour répondre aux urgences de notre temps. Il semblerait pourtant que l’État soit de plus en plus tenté de leur tourner le dos. Les nouvelles annonces de restrictions budgétaires, sans réelle réflexion de fond sur le fonctionnement des finances publiques, continuent de nous inquiéter. Il s’agit là d’une logique à sens unique, qui fragilise les collectivités locales alors qu’elles sont l’un des leviers les plus efficaces de transformation et d’adaptation du pays. Depuis plusieurs années, les collectivités investissent massivement pour moderniser les infrastructures, accompagner les transitions énergétiques et climatiques, renforcer les services publics de proximité. Ces investissements sont autant de réponses concrètes aux défis actuels. Pourtant, loin d’être soutenues, elles sont sommées de faire toujours plus avec toujours moins. Il est urgent de rappeler un fait fondamental : l’investissement public local, qui représente 70 % de l’investissement public, est un moteur puissant du développement économique et social. Chaque euro investi par une commune irrigue le tissu économique local, dynamise l’emploi, améliore le quotidien des habitants. Routes, écoles, réseaux d’eau, équipements culturels ou sportifs, rénovations thermiques : ce sont les collectivités qui assurent l’essentiel de ces missions, dans un cadre budgétaire strict. Contrairement à l’État, les collectivités locales ne peuvent pas emprunter pour financer leur fonctionnement. Elles ne s’endettent que pour investir. Cette règle de gestion, parfois vue comme une contrainte, peut aussi être un atout. Elle impose une gestion rigoureuse et oblige à hiérarchiser les priorités. Elle garantit que la dette contractée aujourd’hui bénéficiera aux générations futures. À l’inverse, l’État a depuis des décennies recours à l’endettement pour financer son fonctionnement courant, creusant un déficit structurel dont les collectivités locales ne sont que très marginalement responsables. En 2023, la part des collectivités dans la dette publique ne représentait qu’environ 10 % de l’ensemble, stable depuis les années 1990. En clair : les collectivités locales n’ont pas contribué au creusement du déficit public. Récemment, le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a évoqué dans un entretien à Ouest France la possible instauration d’une « contribution modeste » pour financer les services publics des communes. Une annonce qui sonne comme un aveu d’échec par rapport à la suppression de la taxe d’habitation décidée par Emmanuel Macron. Les effets de cette réforme ont été décortiqués par la Cour des comptes et les conclusions sont sans appel : plusieurs dizaines de milliards d’euros de manque à gagner et peu d’effets concrets sur la vitalité économique des territoires. Soulignons qu’il résulte également de cette mesure une perte d’autonomie fiscale et donc une plus grande dépendance à l’État pour les communes. C’est ainsi que la situation actuelle s’est tendue : l’État central se prive volontairement de recettes, puis constate un déficit croissant… et décide ensuite de faire porter l’effort sur les autres acteurs publics ou bien de couper dans les services publics. Le 27 avril, c’est la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui a annoncé sur une radio nationale l’intention du gouvernement de supprimer ou de fusionner « d’ici la fin de l’année » un tiers des agences et des opérateurs de l’État pour faire des économies. Si cette proposition voit le jour, ce sont encore une fois des économies à court terme et un retard qui sera pris dans l’application des politiques publiques qu’il nous faudra bien compenser un jour. À cela s’ajoute l’agitation internationale, incarnée par le retour inquiétant de figures comme Donald Trump, et les incertitudes économiques qui en découlent créent une pression supplémentaire. Dans ce climat, les territoires devraient être des refuges de stabilité et de résilience. Or, les collectivités se retrouvent face à un dilemme inextricable : comment continuer à investir massivement pour répondre aux besoins du territoire, anticiper les conséquences du réchauffement climatique, tout en absorbant les coups de rabot successifs imposés par l’État ? Les besoins sont immenses : rénovation énergétique des bâtiments publics, création de logements accessibles, développement des mobilités douces, accompagnement du vieillissement, soutien au tissu associatif… Et pourtant, les marges de manœuvre fondent aussi vite que les glaciers. Les collectivités locales ne doivent pas devenir les variables d’ajustement d’un budget national mal maîtrisé ou volontairement déséquilibré. Ce déséquilibre devient d’autant plus insupportable que l’État, lui, peut légiférer pour créer de nouveaux impôts, réformer les niches fiscales ou instaurer une fiscalité plus juste sur les hauts patrimoines ou les activités polluantes. Les collectivités, elles, n’en ont pas le pouvoir. Il est temps d’inverser la logique. Le gouvernement devrait avoir le courage de rouvrir le débat sur les recettes, en concertation avec les associations d’élus, qui portent des propositions sérieuses et équilibrées. Car ce que les collectivités locales demandent, ce n’est pas un blanc-seing. C’est simplement la reconnaissance de leur rôle central, de leur efficacité, et de leur capacité à transformer la société par l’action de terrain. Les élus locaux savent faire des choix, hiérarchiser, rendre des comptes. À l’État maintenant de montrer la même exemplarité.
Poitiers Collectif
Texte non reçu dans les délais impartis.
Un bel été à Poitiers
La Ville fait le maximum pour que chacun·e puisse profiter des vacances, quel que soit son âge ou ses moyens. Avec « Vacances pour toutes et tous », les enfants comme les aînés ont accès aux loisirs, avec des séjours locaux et adaptés. Celles et ceux qui restent à Poitiers ne sont pas oubliés puisque les baignades sont à l’honneur, que ce soit au bois de Saint-Pierre avec l’ouverture du lagon ou sur les bords du Clain avec la baignade de Tison. La culture n’est pas en reste grâce aux Jeudis de l’été qui, cette année, fêtent les 30 ans de carrière de Pascal Obispo. Un bel été à Poitiers en perspective !
Le groupe